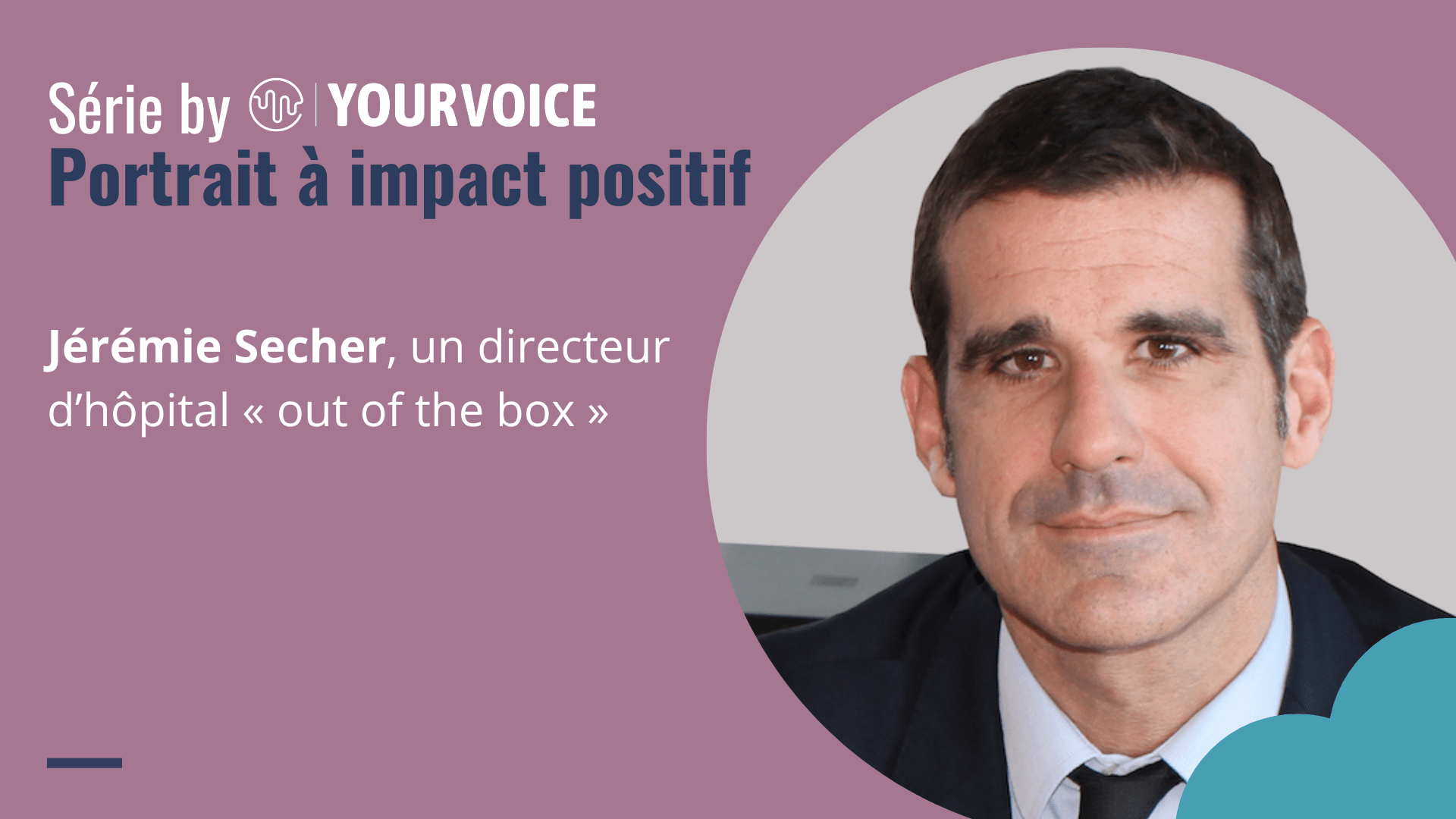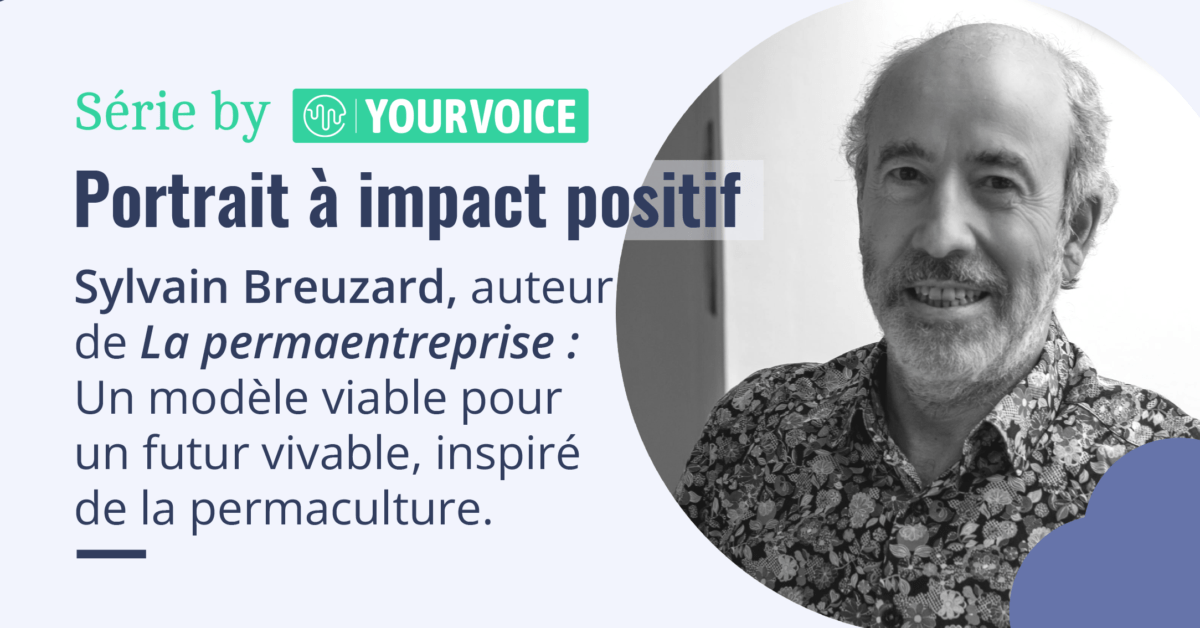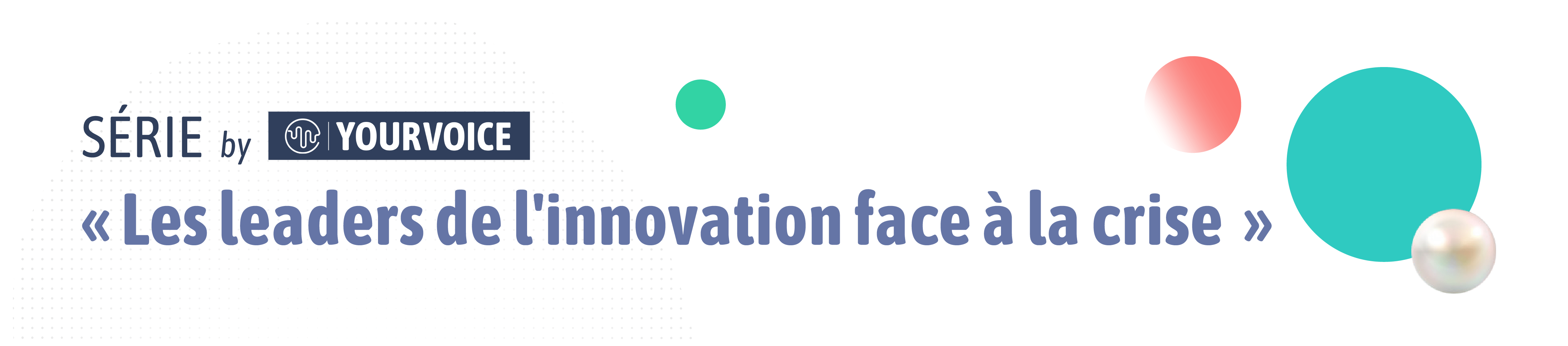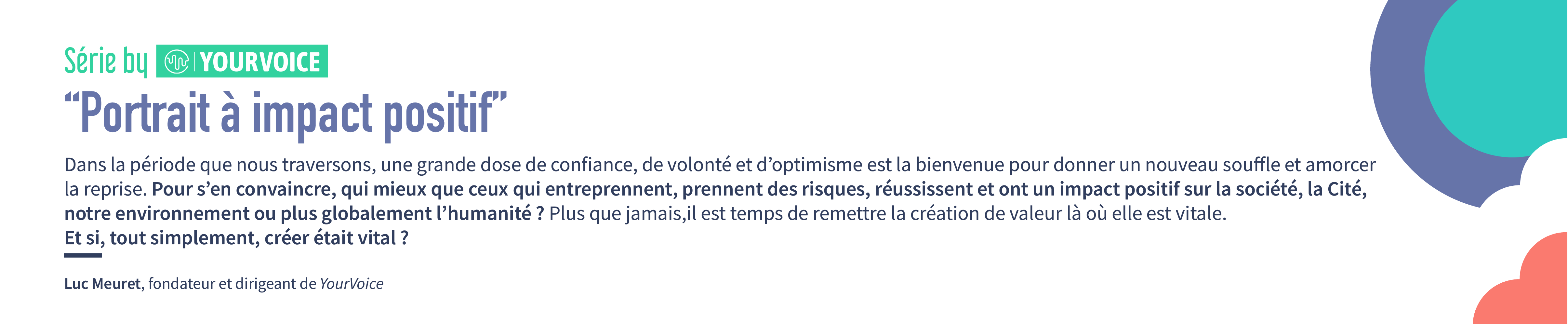
INNOVATION
Saran Diakité Kaba, Directrice générale de Strate, École de Design
29 octobre 2021
Multi-entrepreneuse dès ses études à l’ENSCI Les ateliers, Saran Diakité Kaba a ensuite travaillé en agences de design pour de grands groupes puis dirigé des équipes R&D au sein du Groupe PSA avant de prendre la direction de l’école Strate en 2021. Elle nous parle du design au service du progrès environnemental et de son engagement sociétal de toujours : développer les talents. Son interview est une invitation à passer à l’action.
Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?
J’ai démarré très vite à mon compte en parallèle de mes études à l’ENSCI, avec une double activité de designer d’interaction et de designer sonore. Je faisais le grand écart entre les projets pour les centres de R&D (Thomson, EDF, France Télécom) et ceux pour les défilés de mode et les compagnies de danse contemporaine. En agences de design, j’ai exercé le même métier sur des enjeux d’interaction. Puis, j’ai rejoint Décathlon pour contribuer à la réorganisation du plus grand centre de design de France à l’époque, en lien avec le nouveau business model, soit des business units délocalisées sur les lieux des pratiques sportives. Il fallait donc réinventer le métier et mettre en place une animation transversale pour conserver l’émulation entre les designers ainsi que la capacité de l’entreprise à les faire grandir.
« Quel est le moteur des designers ? Comment les accompagner pour maintenir leurs compétences et leur créativité ? Ces préoccupations m’animent depuis toujours. »
Au sein du groupe PSA, j’ai privilégié l’innovation tirée par les nouveaux usages plutôt que l’innovation poussée par la technologie. J’ai développé l’équipe User experience innovation, un laboratoire-agence interne au service de toutes les directions de PSA. Dans ce cadre, nous avons créé l’Openlab design qui encourage les collaborations entre étudiants de différentes écoles de design et d’autres corps de métiers.
« Dans une équipe, il est enrichissant de pouvoir s’appuyer sur des profils aux postures distinctes, aux compétences complémentaires et qui savent travailler ensemble. Nous devons absolument développer la pédagogie collective des écoles de design. »
Puis, j’ai été peu à peu en charge d’animer la « vie à bord » du projet de véhicule autonome, c’est-à-dire ce à quoi ressemble l’expérience intérieure d’une voiture connectée, intelligente et protectrice, que l’on ne conduit plus. Une aventure technologique et humaine incroyable. En 2016, j’ai finalement été nommée directrice R&D des interactions machine, rattachée au COMEX. Avec mes équipes R&D composées d’ingénieurs, de développeurs, d’électroniciens, d’ergonomes, de designers et de nombreux autres métiers dans le monde entier, notre challenge a consisté à garder un coup d’avance sur nos concurrents en menant la révolution des cockpits et en accompagnant la valorisation de motorisations propres.
En 2020, lorsque le directeur de Strate m’a proposé de prendre sa succession, je me suis rendu compte que je me sentirais encore plus utile si je m’engageais dans l’enseignement supérieur des profils créatifs et innovants pour relever les challenges du XXIème siècle. Depuis deux ans, j’étais présidente du Conseil d’Administration de l’ENSCI et j’ai mesuré à quel point les étudiants étaient déboussolés par la crise sanitaire. Jusque-là, je consacrais 10 % de mon temps à l’enseignement dans différentes écoles, parmi lesquelles Strate.
« Je me suis dit qu’il était temps d’inverser la balance et de consacrer 90 % de mon temps
aux enjeux de la formation à la conception d’un monde soutenable,
et de conserver les 10 % restants pour la R&D. »
Sur quelles ressources vous appuyez-vous pour faire avancer vos projets ou exercer votre leadership ?
Quel que soit le niveau auquel j’ai pu intervenir, à mon compte, en agence, devant les membres du COMEX, les principales ressources que j’ai convoquées pour me sentir juste sont la sincérité et la franchise pour ne jamais avoir à remettre en cause mes engagements jusqu’au-boutistes.
Grâce à la sincérité, les équipes ne nous voient pas uniquement comme un capitaine d’industrie mais aussi comme un être humain qui a des convictions mais que l’on peut aussi convaincre. En restant accessible, à l’écoute et bienveillant, la parole est libre. Les collaborateurs sont plus enclins à parler les problèmes plutôt que de les taire. L’erreur est humaine. Or pour apprendre de ses erreurs, encore faut-il être en situation de pouvoir les partager.
Quels sont vos projets et vos défis actuels ?
Dans le cadre des enseignements proposés aux « Stratos »[1], nous développons un axe autour de l’engagement sur le territoire : le Strate action sociale. L’objectif est d’insuffler le design dans les associations, les mairies, les départements, la Région Ile-de-France…
« Le secteur public a besoin de se réinventer et le design peut servir ce but. Dès la rentrée prochaine, nous allons permettre à nos étudiants designer et à tous ceux qui s’intéressent à l’innovation sociale de travailler ensemble. »
Nous comptons développer ce concept, en l’adaptant au contexte culturel, en Afrique avec l’agence YUX Design, puis en Inde via notre campus à Bangalore. Il est important que nos étudiants apprennent à concevoir pour un environnement qui impose la frugalité.
Le progrès est au cœur de la démarche de design. Or, progrès et innovation ne sont pas synonymes. Une innovation peut être motivée par un objectif de marché, de croissance, de technologie, mais ne pas constituer pour autant un progrès social, sociétal ou environnemental.
« Nous construisons une école ouverte sur le monde, sur les enjeux privés comme publics,
avec la conscience de l’impact du design sur la société et la planète. »
Notre second défi concerne le maintien des compétences tout au long de la carrière pour entretenir l’employabilité et le « petit moteur créatif » des profils innovants, tels que les designers. Le monde évolue, les méthodes, les outils et les logiciels aussi, l’urgence environnementale ou sanitaire s’accélère… De ce fait, la transformation continue des compétences est cruciale pour que les profils restent innovants et dans une dynamique d’impact positif. C’est de l’ordre de la responsabilité sociale des écoles.
Quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes et futurs leaders de l’innovation ?
Nous venons de faire un saut spatio-temporel dans le XXIème siècle. A posteriori, je trouve très intéressant pour la jeunesse d’avoir vécu cette expérience de télétravail subi pour imaginer un nouvel équilibre choisi. Leur flexibilité entre présentiel et distanciel et leur capacité relationnelle à distance sont des points forts qui les accompagneront toute leur carrière, y compris à l’international.
« A Strate, nous formons les faiseurs de demain. Le métier de designer a la capacité de renverser la table, d’inverser les paradigmes et de changer la société. »
Par ailleurs, la période de crise que nous vivons est propice à une démarche plus humaniste, tournée vers l’environnement, le social, la RSE… Par expérience, lorsqu’une entreprise traverse une crise, elle finit souvent par faire appel à l’approche design car celle-ci permet de s’autoriser à fonctionner différemment, à mettre en place de nouveaux processus, de nouveaux business models, de nouvelles offres de produits et de services… L’histoire a montré que toutes les entreprises qui ont su placer le design au bon niveau stratégique ont été récompensées et ont surmonté les crises. A Strate, nous aimons beaucoup cette citation d’Abraham Lincoln : « le meilleur moyen de prédire l’avenir, c’est de le créer »
[1] Étudiants de l’École Strate
Retrouvez toute l’actualité média YourVoice !